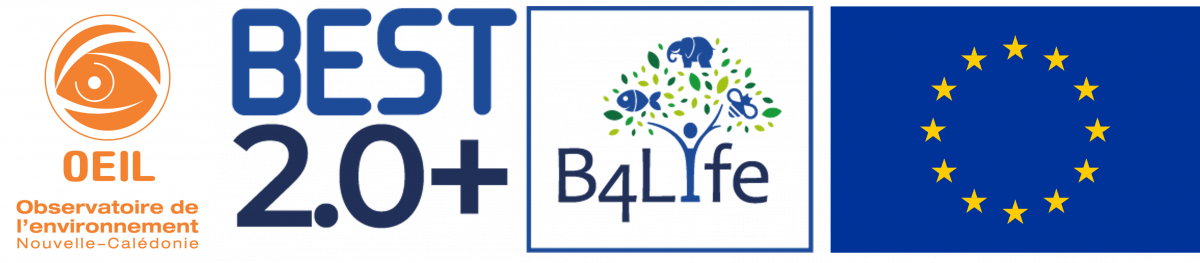- _
- L’OEIL
- Nos activités
- Suivis environnementaux
- Indicateurs
- Pressions et menaces
- Infos générales
- Origines des pressions
- Infos générales
- Incendies
- Mine
- Industrie
- Introduction d'espèces
- Agriculture
- Aménagements, terrassements
- Elevage
- Chasse
- Pêche
- Aquaculture
- Décharges et dépôtoirs
- Prod. thermoélectrique
- Tourisme
- Phénomènes naturels exceptionnels
- Production hydroélectrique
- Rejets d'eaux usées
- Transport maritime
- Transports terrestre et aérien
- Pressions environnementales
- Infos générales
- Acidification de la mer
- Température de la mer
- Courants marins
- Destruction mécanique
- Invasion d'espèces
- Pollution organique
- Pollution lumineuse
- Pollution microbienne
- Pollution métallique
- Pollution par les nutriments
- Pollution sonore
- Prélèvements dans la nature
- Particules de terre
- Apports en eaux douces
- Biodiversité
POLLUX NC
Pollution lumineuse & environnement en Nouvelle-Calédonie
Lauréat du programme européen BEST 2.0+, le projet Pollux NC a été lancé le 7 juillet 2021 et s'est achevé le 31 mars 2023. Son objectif : fournir les premières informations quantifiées sur la pollution lumineuse à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, et émettre des recommandations scientifiques pour sa prise en compte dans les politiques publiques.

Les résultats publiés
-
Pour tout le monde
-
Pour les plus experts
-
La synthèse bibliographique :
"Synthèse des connaissances sur l'impact environnemental de la pollution lumineuse en Nouvelle-Calédonie" -
Le rapport final :
"Caractérisation d'une pression environnementale en Nouvelle-Calédonie : la pollution lumineuse"
-
La synthèse bibliographique :
Pourquoi s’intéresser à la pollution lumineuse ?
- Définition et reconnaissance en tant que pression environnementale
Elle figure parmi les nombreuses pressions que subissent nos milieux naturels, mais sa prise en considération n’a commencé que dans les années 1950, sous l’impulsion des astronomes professionnels qui se sont trouvés gênés dans leurs travaux par l’augmentation croissante des lumières artificielles avec la démocratisation de l’électricité.
Ce n’est que bien plus récemment, depuis les années 2000, que la recherche scientifique s’est intéressée aux effets de la pollution lumineuse au sens environnemental. René Kobler, architecte et ingénieur en environnement, a défini la pollution lumineuse en 2002 comme étant :
« le rayonnement lumineux infrarouge, UV et visible émis à l’extérieur ou vers l’extérieur, et qui par sa direction, intensité ou qualité, peut avoir un effet nuisible ou incommodant sur l’homme, sur le paysage ou les écosystèmes »
Nouméa la nuit - © OEIL
De nombreux travaux attestent aujourd’hui que, outre des effets néfastes sur la santé humaine, les lumières artificielles sont sources de perturbations pour les équilibres des écosystèmes en modifiant les rythmes biologiques des plantes et des animaux, dont plus de la moitié sont nocturnes. L’ampleur du phénomène au niveau mondial a été illustrée dans l'atlas mondial de la luminosité nocturne : en 2016, 83 % de la population mondiale et plus de 99 % de la population des Etats-Unis et de l'Europe vivaient alors sous un ciel pollué par les éclairages artificiels. Un tiers de l'humanité ne voit plus la voie lactée dont 60 % d'Européens et près de 80 % des Nord-Américains.
A l’heure où l’extinction massive des insectes inquiète le monde entier, la pollution lumineuse devient un enjeu majeur de préservation des milieux naturels. Il s’agit désormais de considérer l’obscurité naturelle comme une condition environnementale essentielle au maintien des écosystèmes.
- La pollution lumineuse dans la législation
Ainsi, législateurs et gestionnaires ont commencé à prendre en compte cette pression en France : dans le Grenelle de l’environnement de 2009, puis dans la Loi Biodiversité de 2016. En 2018, la France a pris un arrêté sur « la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses ». Il n’existe pas l’équivalent dans le droit néocalédonien aujourd’hui, mais des démarches sont entreprises par le Cluster Synergie pour l'adoption d'un arrêté territorial.
Les bénéfices en seraient multiples, puisque revoir nos émissions lumineuses revêt également un intérêt économique par la réduction de la facture énergétique, et un autre intérêt écologique par la rationalisation de la consommation d’énergie. Donc mettre en place une stratégie de gestion la pollution lumineuse se situe au carrefour des stratégies d’aménagement du territoire, de transition énergétique, de gestion de l’énergie, de gestion environnementale et d'attractivité touristique et scientifique.
Afin de soutenir et encourager les collectivités et territoires qui s’engagent dans cette voie, les labels internationaux et nationaux tels que Réserve internationale de ciel étoilé (R.I.C.E.), ou « Villes et villages étoilés » peuvent revêtir un intérêt économique, là encore, puisque des destinations exemptes de pollution lumineuse deviennent touristiquement et scitentifiquement attractives.
- Des trames vertes et bleues... et noires !
En Europe, en matière d’aménagement, la décision du Conseil de l’Europe de créer un réseau écologique paneuropéen date de 1995. La France s’est inscrite dans cette démarche en créant la Trame verte et bleue : un réseau de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques visant à améliorer l’état de conservation des habitats naturels et des espèces dans les milieux terrestres et d’eau douce.
Dans la dernière décennie, le concept de Trame noire est venu compléter ce dispositif, avec pour objectif de recréer un réseau écologique propice à la vie nocturne. On en est aux débuts de la démarche puisque seulement quelques projets ont pour l'instant vu le jour en métropole sur la thématique.
La pollution lumineuse en Nouvelle-Calédonie
Bien que peu connue localement, la pollution lumineuse existe pourtant en Nouvelle-Calédonie, conséquence du développement de la population, des villes et des activités nocturnes. Or, comme l'a montré la synthèse des connaissances réalisée au début du projet, la communauté scientifique internationale lui reconnaît un rôle dans de multiples perturbations pour les organismes vivants. Mais qu'elle soit d'origine publique ou privée, la contrôler est aussi bon pour la biodiversité que pour le porte-monnaie, et chacun peut y contribuer.
En tant que hotspot de la biodiversité mondiale, les enjeux de conservation sont pourtant majeurs sur le territoire : des taux d’endémismes pouvant atteindre 80 % sur les végétaux, plus de 90 % pour les lézards, de nombreux sites de reproduction d’espèces protégées d’oiseaux et de tortues marines, 1/3 des récifs intacts de la planète, 6 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, 1 site labellisé Ramsar...
Le projet Pollux NC s’inscrit donc comme un préalable nécessaire à une gestion adaptée aux besoins des populations ainsi qu’aux enjeux de conservation spécifiques des écosystèmes locaux, dans un contexte de transition énergétique et d'inflation généralisée. En mars 2023, le projet a permis de faire un état des connaissances, de décrire l’état de la pollution lumineuse dans le pays, de formuler des mesures de gestion, et de sensibiliser les décideurs ainsi que le grand public à cette problématique.
- Un premier bilan contrasté
Si 68 % du territoire semble épargné, le Grand Nouméa, et les complexes industriels et miniers du nord et du sud affichent des niveaux élevés de pollution lumineuse. Ailleurs, elle touche des zones plus petites, principalement des noyeux urbains ou d'activité économique comme les centres miniers ou les hôtels.

- Des évolutions visibles
Entre 2014 et 2021, des évolutions sont visibles : la quantité de lumière émise diminue dans certains quartiers de Nouméa et à Nakutakoin, ainsi qu'à Lifou. A l'inverse, elle augmente dans les zones de développement urbain comme Koutio ou Dumbéa-sur-mer, et sur les centres miniers ayant intensifié leurs activités nocturnes comme à Canala, Poya ou Thio.
- Nos milieux naturels sont-ils très exposés ?
La seule donnée de suivi des impacts de la pollution lumineuse en Nouvelle-Calédonie existante à ce jour est celle des échouages d'oiseaux marins. D'après les comptages de la Société calédonienne d'ornithologie, du Parc Provincial Zoologique et Forestier et de Prony Resources, au moins 2300 oiseaux marins se sont échoués en 15 ans, dont 75 % sur la période d'avril-mai. Trois espèces sont concernées : le puffin du Pacifique, le pétrel de Gould et le pétrel de Tahiti, les deux dernières figurant sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui évalue le risque d'extinction des espèces.
Par ailleurs, l'étude montre que :
- les zones les plus éclairées la nuit sont concentrées sur la bande littorale,
- les écosystèmes les plus exposés sont les forêts sèches, les mangroves et les récifs côtiers
- les communes où ces écosystèmes sensibles sont les plus exposés sont Dumbéa, le Mont-Dore, Nouméa, Païta et Voh.
Pour (beaucoup) plus de détails, consultez les rapports techniques :
- Synthèse des connaissances sur les impacts environnementaux de la pollution lumineuse en Nouvelle-Calédonie (2022)
- Caractérisation d'une pression environnementale en Nouvelle-Calédonie : la pollution lumineuse (2023)
- 18 recommandations pour un ciel étoilé
Le projet a montré que la prise en compte de la pollution lumineuse dans les politiques publiques en Nouvelle-Calédonie est encore limitée à quelques initiatives, dont certaines ne semblent pas toujours appliquées. Le groupe de travail du projet Pollux NC a proposé 18 actions prioritaires réparties en 4 grands axes de recommandations. Ce plan d'action pourra guider les acteurs locaux, publics et privés, dans leurs prises de décision en la matière.
- Pleinement intégrer la pollution lumineuse dans les politiques publiques
- Etudier et suivre la pollution lumineuse, ses impacts et sa gestion à l'échelle du pays
- Adopter les bonnes pratiques de gestion des parcs d'éclairage public
- Sensibiliser en valorisant le ciel étoilé et la biodiversité nocturne comme un patrimoine
Un point sur la méthode
Pour obtenir ces résultats, l'équipe de l'OEIL a collecté et analysé des données satellitaires de la Nasa, avec un niveau de précision satisfaisant mais qui reste grossier, qui a permis de produire 8 cartes de la pollution lumineuse à l’échelle du territoire, sur la période 2014 à 2021 : cela a permis un état des lieux, et une analyse des évolutions.
Pour aller plus loin, via l’acquisition d’images à très haute définition, une analyse fine a été produite sur un site pilote sélectionné par le comité de pilotage : il s’agit de la zone urbaine Païta – Dumbéa – Mont-Dore, dont l’essor ces dernières années et dans les années à venir avait justifié ce choix. Grâce aux contributions financières supplémentaires de la SCO et de la ville de Nouméa, les zones de Koumac-Kaala Gomen et de Nouméa ont également bénéficié de cette analyse fine.
Enfin, trois sondes déployées au sol, notamment grâce à un partenariat avec le Centre National d'Etudes Spatiales et à la technologie développée par le bureau d'études DarkSkyLab, ont permis d'évaluer la qualité du ciel nocturne en six endroits, et de compléter les résultats obtenus avec les données satellitaires.
L'ensemble de ces informations ont été croisées avec les données géographiques des zones sensibles d'un point de vue environnemental (aire protégée, labellisée, périmètre connu d'espèces menacée, écosystème à haute valeur environnementale...). C'est ce qui permet de déterminer les priorité en matière de gestion et les recommandations qui en découlent.
Qui a participé au projet Pollux NC ?
Un comité de pilotage, constitué le 26 juillet 2021, est composé d’une diversité d’acteurs concernés par la thématique. Il est chargé de veiller au bon déroulement du projet, et d’en arbitrer les orientations stratégiques. A l'issue du projet, ce comité devient le groupe de travail "pollution lumineuse" qui aura vocation à suivre la mise en oeuvre des recommandations issues du projet.
La mise en œuvre est portée par l’équipe de l’OEIL, avec le soutien de son Conseil scientifique et de ses prestataires.
-
Les membres du comité de pilotage et contributeurs : Loïck Mahe (Agence Calédonienne d'Energie - ACE), Jean-Christophe Millot (Association Calédonienne d'Astronomie -ACA), Fabienne Floret (ACA), Pablo Chavance (ADECAL), Samuel Buisson (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - CEREMA), Paul Verny (CEREMA), Christine Fort (Direction du service de l'Etat de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Environnement de Nouvelle-Calédonie - DAFE), Jean-Luc Bernard-Colombat (DAFE), EEC, Florent Domergue (Ecolife NC), Aurélie Fourdrain (Endemia), GIE SERAIL NC, Fabrice Brescia (Institut Agronomique Calédonien - IAC), Eric Vidal (Institut de Recherche et de Développement - IRD), Cristina Romero (UICN/Best2.0+), Noelia Garzon (UICN/Best2.0+), Sarah Eurisouke (Koniambo Nickel SAS - KNS), Christian Wapae (Mairie de Dumbéa), Emile Lakoredine (Mairie de Maré), Frédéric Malaval (Mairie de Païta), Martin Thibault (Museum national d’histoire naturelle - MNHN), Anne Lataste (Observatoire de l’environnement en NC - OEIL), Hugo Roussaffa (OEIL), Fabien Albouy (OEIL), Adrien Bertaud (OEIL), Isabelle Rouet (OEIL), Léa Desoutter (OEIL), Caroline Rouvier (OMEXOM), Fabien Paquier (Office Française de la Biodiversité – OFB), Amélie Le Mieux (OFB), Céline Maurer (OFB), Hortense Lecercle (OFB), Dominique Levy (Province Nord-DAF), Louise Mandaoué (Province Nord -DDEE), Malik Oedin (Province Nord -DDEE), Nicolas Bazire (province Sud – DDDT), François Leborgne (province Sud – DDDT), Manina Tehei (province Sud – DDDT), Laurence Bachet (province Sud – DDDT), Almudena Lorenzo (province Sud – DDDT), Caroline Vieux (SARL Hope !), Liliane Guisgant (Société Calédonienne d’Ornithologie - SCO), David Ugolini (SCO), David Laloy (Ville de Nouméa), Marie Desplats (Ville de Nouméa), Samy Douyere (Ville de Nouméa), Nicolas Oxford (Ville du Mont Dore), Coralie Guillou (Ville du Mont Dore), Pierre-Olivier Castex (Ville du Mont Dore), Sébastien Sarramegna (SLN), Angélique Renucci (Synergie), Marc Oremus (WWF).
- Les partenaires techniques : le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
- Les prestataires : La TeleScop, DarkSkyLab
- Les partenaires financiers :
Les contributions financières et techniques supplémentaires de la SCO et de la ville de Nouméa ont permis d’étendre le périmètre de l’étude.
Le programme BEST 2.0+ : qu’est-ce que c’est ?
L’objectif de BEST 2.0+ est de promouvoir la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable des ressources naturelles et des services écosystémiques, y compris pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, dans les Pays et Territoires d’Outre-mer (PTOM) de l’Union européenne. Best 2.0+ cherche à atteindre son objectif en renforçant les autorités locales et les organisations de la société civile qui sont engagées dans le développement local, la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des services écosystémiques dans les PTOM à travers la mise en œuvre d'un mécanisme de subventions qui s'accompagne d'activités de renforcement des capacités. BEST 2.0+ poursuit l'initiative BEST et constitue une suite directe du programme BEST 2.0.
Pour aller (encore) plus loin
- Le programme BEST 2.0+ (Union européenne)
- Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (Légifrance)
- Le label international Réserve Internationale de Ciel Etoilé dispensé par International Dark-Sky Association
- Le label national Villes et villages étoilés dispensé par l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ANPCEN)
Cette page a été réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne et de son bailleur, la Direction des partenariats internationaux de la Commission européenne (DG INTPA). Son contenu relève de la seule responsabilité de l'OEIL et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne.